Author Archives: Patrick Gandubert
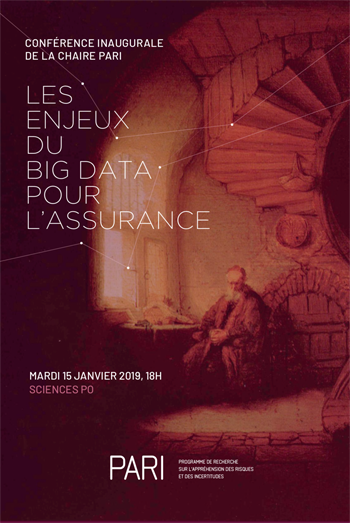
Mardi 15 janvier, 18h
Sciences Po, Paris
Amphithéâtre Jacques Chapsal
27 rue Saint-Guillaume – 75007 Paris
Les intervenants :
Maud Bailly
Chief Digital Officer AccorHotels,
ancienne conseillère du Premier Ministre
Gilles Babinet
Multi-entrepreneur,
Vice-président du Conseil National du Numérique
Avec la participation de :
Daniel Antoni, Directeur général de Thélem assurances
Pierre Arnal, Vice-président de Addactis Group
Bertrand Labilloy, Directeur général de CCR
Christophe Lafond, Vice-président de MGEN
La personnalisation du risque : état de l’art ou quadrature du cercle ?
Le Big Data, dit-on, va changer le monde. L’ampleur de la proposition s’accommode trop souvent de son imprécision, qui touche d’abord la notion même : en désignant simultanément la nature des données – et d’abord leur ampleur – autant que la manière de les interroger, « le big data » renvoie à des enjeux cognitifs, organisationnels et politiques qui, pour être correctement saisis, doivent être décomposés.
Les enjeux de savoir tout d’abord s’organisent autour de conflits inédits, où l’on voit des modèles explicatifs développés par l’économie ou la psychologie depuis des décennies pour rendre compte des comportements humains soudain affronter une concurrence à l’issue incertaine : seront-ils remplacés par des boites noires qui mettent à profit la physique théorique ou les mathématiques appliquées pour attribuer des scores individuels difficilement explicables ? Et quelles ressources décideront de l’issue de cet affrontement ?
Les défis organisationnels renvoient quant à eux autant à la mise en place des systèmes d’informations nécessaires à la production et à l’appariement de ces vastes jeux de données qu’aux transformations de la division du travail que leur traitement sera susceptible d’engendrer : des différents spécialistes qui tentent aujourd’hui de se présenter comme data scientists, qui s’imposera et où ? Et comment se recomposeront les chaînes de valeur où s’inscrivent les organisations qui les emploient ?
L’individualisation prédictive que promettent les modèles rattachés au big data remettent enfin en cause jusqu’au fondement même de notre pacte social, ce qui engendre en retour des restrictions d’usage inédites dont le RGPD n’est peut-être qu’une première déclinaison : où et comment se définira l’équilibre entre les potentialités techniques de sur-segmentation individualisante et la volonté politique de conserver les logiques solidaires qu’elle vient contredire ? Ou faut-il concevoir les principes normatifs d’un vivre ensemble renouvelé, qu’il ne faudrait pas défendre contre ces nouveaux outils de connaissance mais qui, au contraire, en partiraient ?
